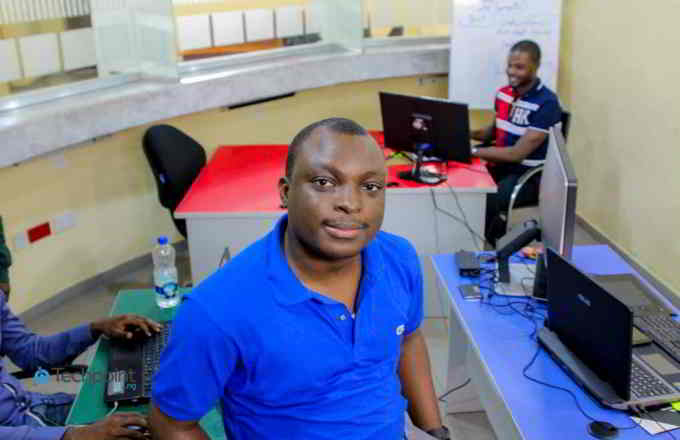Elle assure la survie quotidienne d’importants groupes sociaux à revenus pratiquement inexistants. Brocanteurs, recycleurs d’objets divers, laveurs de voiture ou de moto, « changeurs » de billets de banque ou camelots de pacotille ont envahi les rues et les marchés de la capitale.
Ce sont généralement des diplômés sans emploi, des déflatés de la Fonction publique, des recalés du système éducatif ou de simples exilés ruraux. Ils se « débrouillent » le plus souvent en dehors des lois et du fisc pour survivre ou réunir des fonds. Leur ingéniosité fascine les bailleurs de fonds car ils brassent un important flux de petits capitaux dans une économie qui tire son dynamisme de sa non-formalisation. D’autres activités plus consistantes mais non formalisée au goût du fisc parce que non titulaires d’autorisations administratives, sont exercées publiquement. Ces ateliers vont des studios photo, aux salons de coiffure, des boutiques de cosmétiques aux petits magasins de vente de céréales, de ciment ou de pièces détachées et autres. Cette économie sans visage pratiquée par une multitude de citadins a commencé à prospérer chez nous à partir des années 80 à la suite des ajustements structurels qui ont vu le retrait de l’Etat des principales activités de production ou de commercialisation. Depuis, l’économie informelle reste le meilleur amortisseur de crise sociale avec un fort potentiel de génération de revenus. Les jeunes diplômés, par désespoir ou par manque de courage, s’y lancent en attendant d’avoir plus.
*Le grand marché de Bamako déborde de ces nouveaux opérateurs qui ont entrepris des activités peu formalisées et moins localisées, difficiles voire impossibles à encadrer. Mais face au développement exponentiel du secteur informel, les opérateurs du secteur formel s’inquiètent de plus en plus. Ils pensent à raison que l’économie informelle ne saurait remplacer l’Etat dans son rôle de prestataire de services collectifs, ni les grands groupes dans la fourniture de biens. Et l’apparente victoire, dans de nombreuses régions du monde, de l’économie informelle est une victoire par forfait et ne saurait asseoir les véritables fondements d’un développement durable. Qu’à cela ne tienne, les tenants du secteur commencent à porter un sérieux ombrage aux opérateurs économiques titulaires de patentes, payant les taxes et les impôts, disposant de locaux répertoriés. Les devantures de leurs boutiques sont sauvagement occupées souvent en toute impunité, par des acteurs économiques qui vendent les mêmes produits parfois entrés en fraude sur le territoire national. C’est le cas de Bengaly Coulibaly au marché de Kalaban Coura ACI.
Des jeunes ont pris place devant sa boutique pour exposer des produits qui proviennent de pays voisins. Le commerçant Bengaly est ainsi obligé de prendre son mal en patience. Pour lui « c’est le marché et chacun peut tenter sa chance » même si ses recettes ont chuté. D’autres n’exerçant même pas de profession précise et agissant parfois pour le compte de fonctionnaires de l’Etat ou des employés de banque (comme ces agents informels de change d’argent dans les rues), exercent des activités tout aussi illégales au vu et au su de tout le monde. Mais ces activités procurent des revenus assez substantiels à leurs auteurs. Selon Moussa Touré, un jeune expatrié de retour au Mali, le développement passe inévitablement par un processus d’industrialisation capable de transformer et de valoriser nos produits locaux en vue de satisfaire les besoins fondamentaux de nos populations. Il pense que cela ne peut se faire sans les mesures de protection rigoureuse de nos marchés nationaux et de création des sources de revenu à la population. Ainsi, conclut-il, chacun sera contraint de se conformer à la règle du marché. Le jeune Moussa estime que cette réflexion stratégique ne saurait être laissée aux seuls spécialistes de l’économie, à la classe politique et aux technocrates qui ont du mal à sortir notre pays des impasses. « Il faut en faire l’objet de débats populaires qui permettront à la population d’obliger le pouvoir à se mettre résolument à leur service, à tenir compte des expériences pour prendre en charge leurs préoccupations actuelles et leurs aspirations fondamentales. Cela nous aidera à dessiner des alternatives véritablement nouvelles qui rompent avec les logiques actuelles pour fonder une économie au service de l’homme au lieu qu’il soit écrasé par la dictature du marché mondial », préconise Moussa Touré.
« Quand je suis revenu de la France, ajoute-t-il, j’ai voulu m’investir dans la transformation de beure de karité. Mais on m’a demandé tellement de documents que j’aie fini par tout lâcher car sans apport extérieur, mon capital ne pouvait pas financer tout ça. J’ai même demandé en vain d’investir à crédit tout en promettant de me mettre en règle au fil des ans ». Un autre interlocuteur, Issa Diarra, opère dans l’économie informelle malgré lui même. « Mes parents veulent que je me marie alors que je n’ai pas une source de revenu. Je suis donc obligé de faire ça pour répondre favorablement à leur demande et pouvoir prendre ma future famille en charge », explique-t-il en reconnaissant la violation de la règle du commerce. Il promet de se mettre en règle dès qu’il trouvera les fonds nécessaires à l’exercice de son commerce. Le natif de Banamba, Mahamadou Sogoré, se « débrouille » dans la rue, se faufilant entre les véhicules et risquant sa vie pour exhiber ses produits en attendant de trouver un fonds de commerce. Faguimba Camara a, lui, ouvert un cybercafé après ses études à la FLASH. Après avoir économisé le montant de sa bourse d’études, il a ouvert cet espace sans se mettre en règle. « Des agents de recouvrement de la mairie viennent souvent me soutirer de l’argent, et comme ça fait l’affaire de nous tous, je ne me plains pas ». Comme beaucoup d’autres acteurs de ce secteur, Faguimba plaide pour la tolérance dans un contexte de manque d’emplois des jeunes qui sont sensés constituer le pilier de l’économie du pays. Cette économie solidaire est, bon gré, mal gré, un rempart contre les crises sociales.