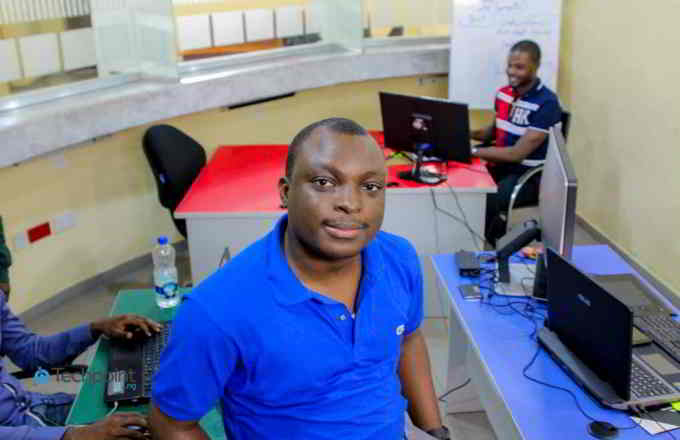Après avoir raté la première et la seconde révolution industrielle, l’Afrique semble bien partie pour adopter la troisième. Dans l’agriculture, le défi est complexe : il s’agit de produire plus, beaucoup plus, tout en limitant les impacts négatifs sur l'environnement. La technologie peut changer la donne et des innovateurs radicaux sont entrés dans le jeu. En combinant services low cost, informations en direct et innovations frugales, en mettant ces facilités à la disposition des exploitations de toutes tailles, l’Internet mobile peut permettre à l’agriculture africaine d’accélérer à la hauteur de ses immenses besoins.
Pour nourrir les 9 ou 10 milliards d’individus que la planète pourrait compter en 2050, l’ONU affirmait en décembre 2013 que les agriculteurs du monde entier devraient ensemble accroître leur production de 70%. Le défi est particulièrement ardu pour l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient. La progression de 50% envisagée aujourd’hui pour les rendements et l’accroissement des surfaces agricoles (seulement 20% de la hausse de la production) ne permettront pas à ces régions de couvrir leurs besoins. L’Afrique, qui est loin d’avoir achevé sa transition démographique, sera particulièrement concernée.
Certes, les situations sont extrêmement contrastées à travers le continent. En Afrique du Nord, la situation de la malnutrition est restée stable et même relativement proche de celle des régions développées, mais l’Afrique subsaharienne continue d’inspirer de graves inquiétudes. En 2050, affirme l’ONU, la population de l’Afrique atteindra 2,4 milliards d’habitants. Sans une authentique révolution agricole, le pire attend le continent. Pour atteindre en 2015 les fameux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), il faudrait que le nombre des sous-alimentés en Afrique diminue de moitié par rapport au début des années 1990, c’est-à-dire qu’il passe sous la barre des 90 millions de personnes. C’est impossible dans ces délais. À plus long terme, le défi est tout aussi criant.
Dans son rapport 2013 sur « l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde » (en anglais), la Food & Agriculture Organisation (FAO) de l’ONU estimait à 239 millions le nombre d’Africains sous-alimentés sur la période 2010-2012, soit 19 millions de plus que sur la période 2007-2009. Et la progression ne se fait pas seulement en valeur absolue. La prévalence de la sous-alimentation est passée de 22,6 % à 22,9 %. Dans son rapport « Intensification durable : un nouveau paradigme pour l’agriculture africaine » (en anglais), le Montpellier Panel, un groupe d’experts internationaux hébergé par l’Imperial College of London, offrait un diagnostic encore plus alarmant : en continuant sur la pente actuelle, les systèmes de production agricole africains ne seront pas capables, en 2050, d’assurer plus de 13 % des besoins alimentaires du continent.
Le défi de la production
Face à ce constat, l’effort agricole est insuffisant. L’agriculture fournit 70% de l’emploi du continent et 30% de son PIB, mais seulement cinq pays africains consacrent au moins 10% de leurs dépenses totales au secteur agricole : le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Mali, le Niger et le Sénégal. À l’exception de l’Éthiopie, aucune des dix plus grandes puissances agricoles en Afrique n’a atteint cet objectif, constatent les chercheurs de Resakss, le réseau chargé de surveiller l’application du très stratégique Programme Détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Et seuls six pays ont dépassé les 6% de croissance agricole : l’Angola, la Guinée, le Nigeria, l’Éthiopie, le Rwanda et le Mozambique. Avec la distribution d’engrais et de semences, les cultures locales de maïs et de riz sont devenues plus productives, mais pas à la hauteur des besoins prévisibles.
Le défi est complexe : il s’agit de produire plus, beaucoup plus, tout en limitant les impacts négatifs sur l’environnement. Le changement climatique est un élément central : il s’agit aussi bien d’anticiper certains de ses effets que de développer des solutions qui ne l’aggravent pas. La question de la déforestation, ainsi, est sous contrainte.
Longtemps, certains agronomes venus du Nord (Est et Ouest confondus) ont imaginé introduire en Afrique les grandes exploitations mécanisées de plusieurs milliers d’hectares que l’on trouve dans le Kansas, en Argentine ou en Ukraine. Aujourd’hui, la plupart des experts se retrouvent autour d’une autre stratégie : renoncer à l’extension massive des terres agricoles et intensifier la production des petites exploitations. Pour cela, l’intensification doit être triple. Écologique, tout d’abord, en utilisant des processus écologiques pour favoriser l’efficacité de la production (sols vivants, culture sans labour, parasites de parasites plutôt que pesticides). Génétique, ensuite, en sélectionnant les semences les plus performantes, y compris les OGM ; et enfin socio-économique, avec un environnement et des infrastructures de marché favorables.
Une question centrale demeure : qu’est ce que l’Afrique doit, et ne doit pas, produire ? Cultures vivrières pour la consommation locale ou cultures d’exportation pour accumuler des devises et réduire le déficit commercial ? La réponse est loin d’être univoque mais les principes sont connus : d’abord, la course à l’autosuffisance est loin d’être une stratégie gagnante pour tous les pays et l’Afrique du Nord, par exemple, continuera d’acheter du blé. Ensuite, plusieurs pays ont des avantages comparatifs sur les cultures d’exportation tropicales et doivent les valoriser, mais sans sacrifier l’essentiel. Les cultures d’exportation intéressent les investisseurs du Nord, ce qui n’est pas le cas de la production d’œufs, de maïs ou de manioc. Pour prendre un exemple emblématique, la Zambie ne devrait pas avoir à importer des Pays-Bas des poussins de trois mois.
Il n’existe pas de recette africaine globale mais certains pays africains ont trouvé leur voie. Le Ghana, par exemple, a réussi à mobiliser ses petits producteurs sur des cultures d’exportation comme l’hévéa ou le cacao, avec des systèmes de financement bien adaptés. De même, le fleuve Sénégal est une réussite agricole obtenue grâce à une combinaison d’investissements publics, de techniques d’irrigation et de taxation du riz asiatique – l’ensemble de ces actions a permis de réduire considérablement le déficit commercial en riz.
Le contexte économique et ses contraintes
Indispensable, la hausse de la production n’est pas suffisante. La production agricole peut progresser sans que l’insécurité alimentaire recule en proportion si le pouvoir d’achat des ménages reste trop faible. Les crises récentes ont été liées à l’envolée des prix. Il faut donc augmenter la performance agricole sans provoquer de chômage, ce qui obligera économistes et décideurs à reconsidérer le concept de productivité, à le replacer dans un contexte économique et social global. Avec la croissance démographique, 300 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail en Afrique subsaharienne. Leur donner un emploi est une priorité. Produire plus, en Afrique et ailleurs, impose aussi une nouvelle organisation commerciale des produits agricoles pour protéger les petits paysans mais aussi une politique de stockage pour atténuer la volatilité des cours. Il faut des prix agricoles assez élevés pour inciter les paysans à produire et à investir sans être trop élevés afin de protéger le pouvoir d’achat des populations urbaines en expansion rapide.
Il y a évidemment des avis plus optimistes. En se fondant sur le fait que seulement 30 % des terres agricoles sont exploitées à l’échelle du continent (40 % en Afrique de l’ouest), certaines multinationales de l’agroalimentaire assurent qu’en 2050, l’Afrique subsaharienne sera un « marché d’origination », c’est-à-dire, une région exportatrice de nombreuses matières premières agricoles. Il faudrait pour cela combler deux retards criants. D’abord, le manque d’infrastructures : faute de routes ou de ports, certaines terres restent quasiment inaccessibles et certaines récoltes intransportables. Dans la région subsaharienne, explique la FAO, la quantité de nourriture perdue avant d’arriver dans l’assiette du consommateur dépasse les 150 kg par an et par personne. En outre, les rendements sont très bas. Pour décoller, l’agriculture doit être entièrement réorganisée, notamment en terme d’éducation, de formation, de sélection des semences et des engrais. Pour augmenter la productivité, elle cherchera à augmenter la mécanisation, ce qui implique une baisse de l’emploi agricole et suppose que d’autres secteurs se diversifient pour éviter un exode rural massif. Répétons-le, réformer l’agriculture africaine sans provoquer de crise sociale supplémentaire sera une gageure.
Autre grande lacune, l’absence de filières structurées et efficientes (production, stockage, transport, transformations, distribution) rend difficile le développement. Sans filière intégrée, pas de véritable compétence métier, pas de produits transformés, et donc pas de valeur ajoutée. Prenons le cas du Niger. En dépit d‘une croissance économique vigoureuse (10% en 2012), et même s’il dispose d’un des plus gros cheptels de ruminants de la zone, ce pays grand comme presque trois fois la France, ne possède pas d’installation d’abattage techniquement adaptée aux normes sanitaires et aux enjeux du pays, ni d’équipement pour garantir la chaîne du froid, ni d’usine de transformation laitière… Il ne dispose également d’aucun moyen de transport continental (pas de chemin de fer) permettant de fluidifier les échanges avec ses voisins et les grands ports marchands. Dans des pays aussi vastes, relativement peu peuplés, la distribution doit opérer à longue distance, ce qui rend la logistique décisive.
La faiblesse des politiques agricoles est intimement liée aux difficultés que rencontrent les politiques d’aménagement et de développement socioéconomique des territoires. Pour être efficaces, ces politiques agricoles et agro-industrielles doivent nécessairement prendre en compte les traditions culturelles, la très grande complexité des questions foncières, les politiques énergétiques, les politiques de l’eau, la gestion des risques naturels, ainsi que celle des transports et des équipements. Dessiner une politique agricole exige donc des investissements dans les infrastructures et le développement de politiques publiques au-delà du secteur agricole. Cela requiert des compétences fortes en ingénierie publique comme en conception et en mise en œuvre des politiques publiques. C’est en priorité de ces compétences que l’Afrique subsaharienne a besoin.
La sous-région manque cruellement des centres d’excellence agronomique et agroalimentaire qui formeraient des techniciens, des cadres exploitants, des transformateurs, des ingénieurs agroindustriels, des logisticiens et lui permettraient de renforcer ses capacités d’innovation et d’améliorer la conduite des opérations de production. Ces lacunes s’expliquent. Les programmes d’aide au développement ont jusqu’alors été consacrés soit à l’urgence alimentaire et à l’autosuffisance paysanne, soit à la création d’infrastructures, mais sans un accompagnement suffisant des compétences et des capacités pour utiliser et surtout maintenir ces infrastructures. La mise en place de la Plateforme pour l’Agriculture Tropicale (TAP) animée par la FAO, approuvée par le G8 et lancée lors de la première réunion des experts agricoles (Meeting of Agriculture Chief Scientists (MACS) dirigée par le G20 (en septembre 2012), résulte de cette analyse, de même que les objectifs du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD de Union africaine).
Enfin les pays de cette zone sont aussi soumis aux défis issus de la globalisation des échanges agricoles et des produits agro-industriels. Le niveau de développement des pays industrialisés est aujourd’hui la référence (notamment sur le plan sanitaire) imposée à l’ensemble des pays dans le contexte de l’OMC. Pour atteindre ce niveau de référence, il est très important que ces pays se dotent de leurs propres capacités techniques, économiques et d’une expertise, notamment sanitaire.
Les TIC à la rescousse
Parallèlement à cet effort d’éducation et de formation, l’Afrique prend conscience de l’apport décisif que pourrait représenter l’innovation technologique. Il s’agit d’abord, bien sûr, des progrès dans les méthodes agricoles, et notamment du savoir accumulé ces dernières années dans le domaine de l’agro-écologie. L’enjeu est double : il s’agit à la fois de préserver à court-moyen terme le potentiel des terres agricoles en évitant de les fragiliser, et de parier sur l’avenir : vu le changement climatique, les terres agricoles favorables à la culture vont devenir un facteur rare, un atout décisif dans la compétition internationale. La mise en œuvre d’une agronomie innovante relève ici d’une vision stratégique de ce que sera le monde dans trente ans.
Mais c’est aussi l’innovation technologique dans son ensemble qui peut faire la différence, et tout particulièrement les technologies de l’information. Internet, surtout dans sa version mobile, peut apporter à l’agriculture africaine des gains de productivité considérables, à la mesure du déficit de rendement accumulé par le continent. Dans son rapport « Lions go Digital », le cabinet McKinsey les estime en 2013 à 3 milliards de dollars par an d’ici à 2025.
Les exemples abondent déjà. Il s’agit évidemment d’abord de mieux gérer la production et d’éviter les déperditions inutiles. Les solutions existent : pour éviter la détérioration de la viande, les abattoirs peuvent utiliser des thermomètres et des hygromètres numériques, transmettre les données par smartphones et recevoir, de la part d’experts pouvant se trouver partout en Afrique ou dans le monde, des conseils sur le transport et le stockage de certains produits sensibles comme les viandes. Un moyen très bon marché pour éviter des crises sanitaires.
Internet se révèle aussi une puissante arme contre la prévarication. Le Nigeria a intégré l’Internet mobile dans son programme de soutien aux agriculteurs. Seulement 11% des paysans avaient accès à l’ancien système de subventions aux engrais et des sommes énormes ont été détournées par la corruption. Le nouveau programme d’e-portefeuille lancé en 2012, adresse les vouchers de subvention directement sur les téléphones mobiles des agriculteurs et dirige ceux-ci vers le concessionnaire le plus proche. Le pays a réalisé des économies considérables, il dispose désormais d’une distribution plus efficace des engrais et a atteint son objectif de production. Quant aux agriculteurs, leur capacité d’investissement s’en trouve accrue, et avec elle leur capacité à développer leur productivité.
L’accès à des informations pertinentes est aussi un enjeu fort, aussi bien pour la culture proprement dite que pour une bonne appréhension des marchés. Internet peut améliorer l’accès des agriculteurs à l’expertise et à l’information sur la météo, le choix des cultures et la lutte antiparasitaire, mais aussi sur la gestion et la finance, ce soutien étant disponible tout au long du cycle agricole. La Bourse éthiopienne des marchandises (ECX) reçoit chaque mois plus d’un million de demandes d’informations sur le marché, 80% provenant de zones rurales. La bourse d’Afrique de l’Est fournit en ligne des services comme l’entreposage, la logistique et l’intelligence de marché sur les stocks et les rendements attendus des principales cultures.
D’autres initiatives, souvent très locales, sont à signaler. Au Kenya, la plateforme iCow a été développée pour les petits producteurs laitiers. Elle distribue de l’information en ligne et sur les téléphones mobile, ainsi que des vidéos éducatives. Cette initiative aurait permis d’augmenter de 30 % la production de lait de ses utilisateurs. En Ouganda, un centre d’appels existe, qui fournit aux agriculteurs des compétences en quatre langues sur les récoltes, le bétail, la météo, les prix du marché et les fournisseurs d’intrants. Internet joue également un rôle-clé dans l’accès aux marchés, c’est-à-dire, en pratique, aux meilleurs prix pour les produits et les bêtes. Dans de nombreux pays africains, Esoko fournit des conseils hebdomadaires aux agriculteurs à travers les téléphones mobiles, ce qui leur permet de négocier de meilleurs prix, de choisir entre plusieurs marchés et de recevoir des offres pour leurs produits. Selon McKinsey, les adhérents à Esoko ont vu leurs revenus croître de plus de 20%. Internet permet aussi aux producteurs de café en Afrique de l’Est ou de cacao, en Afrique de l’Ouest, de suivre les échanges de produits de base à New York. Internet transforme ce qui était une jungle impénétrable en un marché plus transparent.